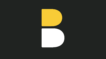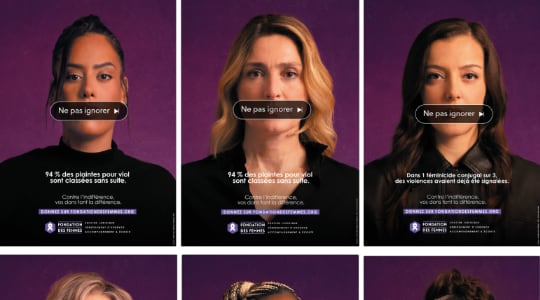L'interview d'Alexander Kalchev, DDB Paris.
Dès aujourd’hui, la 66e édition des Cannes Lions vient récompenser les campagnes les plus créatives de l’année. Une année placée sous le signe de l’entertainment et des nouveaux médias. Jeffrey Katzenberg, célèbre « exec » du divertissement, co-créateur de Dreamworks et patron de Quibi, plateforme de SVOD « mobile-first » lancée au dernier SXSW, sera élu « personnalité média de l’année ».
Parallèlement et comme un retour à la pop-culture de la fin du XXe, la création publicitaire fait de plus en plus place aux méthodes et aux codes de l’entertainment, à l’instar des nombreux et longs films publicitaires sortis ces derniers mois : Intermarché, Monoprix, le Puy du Fou…
Ce regain du divertissement nous donne l’occasion de nous entretenir avec Alexander Kalchev, directeur de la création de [tag]DDB Paris[/tag] et directeur de création de l’année au Club des DA 2019, qui est passé en quelques années d’une approche très « stunt » à des productions publicitaires lorgnant le cinéma. Une interview « Jeunes loups » aussi bavarde que passionnante, dont nous vous recommandons vivement la lecture…
Quel est le principal défi actuel des créatifs ?
Alexander Kalchev : Le temps. Et surtout, le manque de temps. C’est un peu caricatural, mais les idées viennent souvent lorsque l’on s’y attend le moins. Lorsque vous briefez quelqu’un, il est impossible de prévoir comment cela va se passer. Avant, vous aviez un peu de temps pour échanger, discuter, réfléchir ou vous perdre. Aujourd’hui, nous vivons dans un temps compressé, accéléré et inondé de contenus. La tendance actuelle est à l’optimisation : trouver des solutions rapidement, les produire en un rien de temps. Avec deux jours pour tout faire, c’est la solution de facilité qui l’emporte, cela donne un résultat déjà vu ou « propre ». Et pourtant, c’est la pire chose que l’on puisse dire à un créatif sur son travail, « c’est propre ».
Vous avez été nommé directeur de création de l’année au Club des DA pour la 2e année consécutive, comment l’expliquez-vous ?
AK : Le volume et la très grande diversité de projets produits par DDB aujourd’hui est la chose dont je suis le plus fier. Chaque équipe est libre d’être elle-même, de faire des choses inattendues. J’essaie de protéger cette indépendance créative. Ce prix de directeur de la création de l’année récompense un travail collectif et tous les prix reçus par ces équipes.
J’ai la chance de travailler avec des gens différents que j’apprécie et auxquels je crois. Ils peuvent me surprendre, me faire peur, rire et pleurer parfois. C’est une chance unique de pouvoir travailler avec autant de gens talentueux. Donc le prix de DC de l’année, c’est le leur, pas le mien. Je monte juste sur scène à la fin pour le récupérer. Mon job, c’est d’essayer de créer cet espace où ils n’ont pas peur d’être eux-mêmes et de faire des erreurs.
C’est important qu’ils soient heureux, nous ne parlons pas assez souvent du bonheur au travail, alors que l’on passe énormément de temps dans nos agences. Je suis convaincu que ce qui rend les créatifs heureux, c’est le travail rendu : il y a une fierté et une énergie impossibles à prévoir. Il faut qu’ils se sentent libres et protégés pour cela. Et si nous gagnons autant de prix, c’est aussi parce qu’ils sont heureux et fiers d’être là. Depuis quatre ans, je sens cette fierté augmenter.
Sur quelle tendance créative avez-vous envie de parier pour les mois à venir ?
AK : Je ne suis pas très « tendances ». En revanche, j’aimerais que les marques se prennent moins au sérieux, qu’elles n’aient pas honte de faire de la publicité. De la bonne publicité. Sans tenter de sauver le monde. J’aimerais plus d’humilité, de sincérité et de rires. Cela ne ferait pas de mal.
Avant, il n’y avait rien de plus normal à réaliser une publicité de trente secondes avec une simple blague, cela s’arrêtait là. Aujourd’hui, il faut faire un manifeste, du brand content autour de tous ses engagements, des entretiens avec les fournisseurs, etc. Cela rassure surtout les agences et les clients, mais est-ce que les gens sont véritablement touchés ? En 2014, lorsque nous avons fait Fleury Michon, « Venez vérifier » (prix Effie catégorie alimentation), autour du surimi, le sujet avait beau être très sérieux, la tonalité n’en était pas moins drôle, et cela a très bien marché.
Vous semblez affectionner particulièrement les films publicitaires depuis quelque temps. Alors que votre parcours laisse plutôt présager des activations hors format… Comment expliquez-vous ce virage ?
AK : J’ai grandi, peut-être ! C’était une époque où Internet était encore un peu « sauvage », l’expérimentation avait toute sa place, c’était excitant parce que nouveau. Faire un site interactif ou un billboard avec des oranges (pour Tropicana, NDLR) nous paraissait la chose la plus normale sur Terre. Tous les projets de stunts que j’ai pu faire ont été rendus possibles parce qu’il y avait une certaine liberté et pas de frontières. Tous les jours nous pouvions sortir quelque chose qui n’avait rien d’un objet publicitaire.
Aujourd’hui, c’est plus difficile. En agence nous n’avons pas de temps et les gens n’ont plus le temps de s’attarder 10 minutes sur un site expérimental. Le mobile a tué beaucoup d’expérimentation dans le digital : à une époque, nous faisons tous des applications que personne ne téléchargeait. Aujourd’hui, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux et les formats innovants se font rares (sur Facebook et YouTube notamment). Tout est formaté, Internet est devenu beaucoup plus sage – exception faite pour 4chan, les meme, etc. – même si en termes de production publicitaire quelques expériences se tentent, comme des essais dans la réalité augmentée. La raison pour laquelle nous avons réalisé cette activation digitale en réalité augmentée pour The Division (Ubisoft) est qu’elle se déroulait dans Facebook Messenger : l’audience était déjà là. Le même projet avec une application à télécharger n’aurait pas été envisageable, les gens n’auraient pas téléchargé l’app.
Qu’est-ce qui vous plait tant dans les films publicitaires ?
AK : J’ai toujours adoré les films, c’est la meilleure manière de raconter les histoires selon moi. J’aime tout le process autour : l’écriture des scripts, chercher un réalisateur, réfléchir à tous les détails, me retrouver sur un plateau de tournage – où tu as beau tout prévoir, il y a toujours des imprévus – et tout le process de la création jusqu’au montage. J’aime beaucoup le cinéma, rien ne peut remplacer cette magie lorsque tu te retrouves face à un écran. Le dernier Almodovar, Douleur et Gloire, est incroyable : il parvient à te toucher, te faire rire, pleurer et réfléchir en une scène. La publicité ne véhicule généralement qu’une seule émotion, c’est pourquoi les meilleurs films publicitaires sont ceux qui parviennent à nous faire ressentir plusieurs émotions.
Je pense à She’s always a woman de John Lewis. Il y a une certaine sincérité et une simplicité dans la façon dont l’histoire est racontée, qui ferait presque oublier que c’est une publicité. Ils ont réussi à atteindre quelque chose de très fragile, comme le film Intermarché #lamourlamour.
C’était excitant de faire des projets qui ne ressemblaient pas à de la publicité. Avec le temps, je cherche à mieux comprendre les êtres humains et raconter des histoires qui les touchent, les sortent de leur quotidien et les font marrer.
À quoi attribuez-vous le retour en force du film de marque, loin de tout discours commercial ?
AK : Le film publicitaire n’est jamais parti, et s’il y a un retour, c’est tout simplement parce que cela marche. Mieux qu’une activation complexe ou une installation. Le film touche plus de monde, provoque plus d’émotions et reste dans les mémoires. J’associe cela à l’explosion des séries : le nombre de choses que les gens regardent aujourd’hui, ce sont des histoires racontées sous format audiovisuel, cela reste le meilleur moyen de toucher les gens.
Beaucoup de marques sont dans une recherche de sens actuellement, elle tente de justifier leur existence et beaucoup de films de marques qui sortent aujourd’hui ont cette vocation-là. Certaines d’entre elles n’ont aucune raison d’exister. Une étude disait : si 93% des marques disparaissent, les gens ne s’en rendraient même pas compte. Je n’en suis pas étonné. Les marketeurs sont dans une recherche de sens. Et souvent, le meilleur moyen pour exprimer cela, c’est un film de marque. Gillette l’a fait récemment et quand Nike fait Dream Crazy, cela fonctionne parce qu’ils s’engagent depuis 30 ans sur ces causes. Il y a 20 ans, Nike sortait un film sur Tiger Woods, Hello World – que je trouve beaucoup plus fort que Dream Crazy – dans lequel ils défendaient déjà les athlètes noirs. La marque est donc légitime, quand d’autres sont vraiment opportunistes.
Ce nouvel essor du film va-t-il à l’encontre d’une époque où l’on parle de data, de publicité ultra ciblée voire personnalisée ?
AK : Depuis quelques années, Byron Sharp et Les Binet, challengent la perception du ciblage marketing (et de la fidélisation). L’un montre que l’ultra personnalisation des messages ne fonctionne pas, ou pas si bien que ça. La loyauté envers une marque c’est du bullshit : créer une communauté de fans et de followers puis les cibler, n’est pas la solution idéale d’après les statistiques. Il faut taper large et parler à tout le monde pour recruter.
Et Les Binet, qui est depuis trente ans le patron de l’efficacité chez Adam & Eve DDB et le « maître » de l’IPA (International Planning Association), explique dans son livre The Long and the Short of it: Balancing Short and Long-Term Marketing Strategies qu’il est préférable de communiquer sur le long terme, sinon votre marque s’essouffle. Les campagnes les plus primées sont paradoxalement les plus efficaces : les campagnes créatives sont même 11 fois plus efficaces. Jusqu’à aujourd’hui, le discours dominant était : court-terme, engagement, likes, clics, etc.
Grâce à leur travail et celui de Mark Ritson, la tendance ressemblera à un mix plus sain dans les années à venir. Par exemple, Adidas a récemment annoncé changer de stratégie marketing pour privilégier une vision à long terme. Il y a une prise de conscience, peut-être moins en France, qu’on ne peut pas faire uniquement du court terme : il faut avoir une vision et la tenir sans changer de messages toutes les deux semaines.
Pourquoi nous rappelons nous autant des publicités des années 80-90 ? Déjà, il y avait moins d’écrans, mais surtout nous les avons vu pendant 4-5 ans, nous avions du temps pour les mémoriser, pour que le message s’installe. Aujourd’hui, on change tout, tout le temps, donc nous ne construisons pas de marques. C’est une bonne nouvelle pour les agences, car nous savons créer de la valeur, des choses intangibles. Le travail qui a été fait sur Volkswagen en est une illustration : il y a un énorme attachement à cette marque, notamment grâce à la communication. Les agences ne vont pas mourir, contrairement à ce qui se dit ces derniers temps.
Vous êtes devenu directeur de la création de DDB Paris à tout juste trente ans. Comment arrive-t-on à diriger si jeune la création d’une aussi grande agence ?
AK : Avec pas mal de stress déjà ! J’espère ne jamais être dans cette posture du gourou omniscient qui prend toutes les décisions, comme un Roi Soleil. Cela marche avec certaines personnes et agences, mais ce qui m’intéressait était d’obtenir le meilleur de mes équipes. Une volonté qui requiert une certaine humilité et une capacité d’écoute, même si je prends la décision finale. J’ai donc fait confiance aux gens autour de moi, tout en étant transparent sur ce que je ne savais pas faire par exemple. Si nous sommes suffisamment sincères, si nous nous faisons confiance, nous ne pouvons pas vraiment nous planter.
Après, j’ai une passion pour le craft, c’est essentiel pour moi. S’ouvrir l’esprit, aller chercher des gens avec qui nous n’aurions jamais osé ou rêvé de travailler, comme Nicolas Refn, Ridley Scott. Ce n’est pas si compliqué, il faut oser, alors qu’on s’interdit beaucoup trop de choses. En faisant de son mieux, on peut sortir des projets qui rendent jalouses les meilleures agences et stars de la planète.
Tout cela s’est fait de manière très intuitive. Avec les responsabilités, certains créatifs qui deviennent directeur de création – ou pire directeur de la création ! – pensent qu’ils pourront rester créatifs et n’acceptent pas de voir leur identité changer complètement. Désormais, vous devez être là pour les autres, et si vous n’êtes pas prêt à ça, c’est compliqué.
Quel conseil donneriez-vous à un.e jeune créatif.ve qui commencerait sa carrière aujourd’hui ?
AK : Il faut vraiment aimer ce métier. Avant, produire soi-même des choses était difficile, aujourd’hui, c’est à la portée de tout le monde : à 20 ans, il est possible de prendre une caméra et de réaliser. Un aspirant créatif doit se poser la question : est-ce que j’aime ce métier ? Tout le reste, c’est de la frustration, beaucoup de projets avortés, mais aussi des moments magiques quand l’idée est trouvée, tous les créatifs le savent. Il faut aimer ce métier, si c’est le cas, mon vrai conseil, c’est d’être soi-même, car vous ferez ce métier toute votre vie. C’est la seule condition pour se sentir à sa place et en accord avec soi-même. La motivation viendra de cette passion. Il faut chercher les personnes qui nous feront grandir, un mentor. J’ai la chance d’avoir rencontré Alexandre Hervé assez tôt et qu’il ait cru en moi.
Quelles sont vos sources d’inspiration principales ?
AK : Elles changent tous les jours. Je suis très curieux, assez vorace. J’apprécie énormément la photographie, mais ce n’est pas la seule chose qui m’inspire. Récemment, c’est dans la série Fleabag que je trouve l’inspiration. La série originale est incroyable. Mon fils est également une source inépuisable d’inspiration, le voir découvrir et imaginer des choses, c’est fascinant.
Comment voyez-vous la création et le métier de créatif évoluer dans les années à venir ?
AK : J’aime le changement, mais aussi les choses qui perdurent. Je ne vois pas les gens changer fondamentalement, même si beaucoup de choses changent dans nos vies. Ce qui nous fait pleurer, rire, ce qui nous touche, l’amour, la peur pour nos proches, etc. tout cela ne changera pas. Les moyens vont changer, les médias aussi sans doute et peut-être que la nouvelle génération (les 11-15 ans aujourd’hui) va être compliquée à comprendre, mais au fond ce sont des êtres humains comme nous qui auront les mêmes sentiments.
Il y a le contexte et le message. Le contexte va changer, le message j’ai du mal à croire qu’il changera. Beaucoup prennent le contexte pour le message, être là dans l’instant, il faut toutefois avoir quelque chose à dire.
Je pense que les créatifs seront encore plus des « faiseurs » : ils pourront réaliser des projets plus fous. Depuis 10-15 ans, nous avons un peu perdu cet aspect-là, avec les ordinateurs notamment. Ceux qui réussiront se seront les faiseurs.
—
* (Le DC de l’année… selon le Club des DA !)